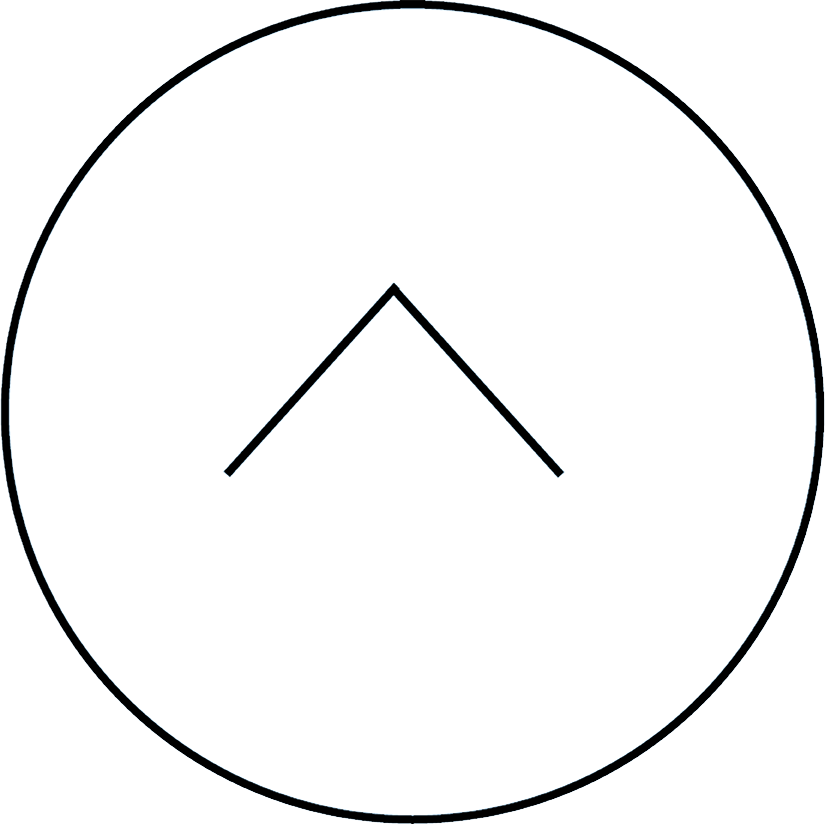L’enregistrement de Bonnie and Clyde, au studio Barclay, avenue Hoche, avec Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg.
Le témoignage de Claude Bergerat, alias Claude Dejacques, premier directeur artistique de Philips, Pathé Marconi..
Quand on est directeur artistique, on court de studios en studios. Les faux, les illustres, ceux qui sont perdus en banlieue…
 Sous le pseudonyme de Claude Dejacques, Claude Bergerat traverse les années 60, 70 qu’il va parcourir comme directeur artistique pour Philips, Festival, Pathé-Marconi. Il sera le 1er directeur artistique dont le nom apparait au dos des disques. La liste des artistes qu’il a accompagnés ou découverts est éloquente : Barbara, Maxime le Forestier, Yves Simon, Nougaro, Higelin. Dans Piégée la chanson, un ouvrage malheureusement épuisé, il raconte avec truculence et une sincérité émouvante l’arrière-boutique, les joies et les déceptions de son métier et l’évolution de la chanson et de la musique enregistrée en industrie. Les studios qu’il visite sont fameux ou n’existent parfois que sur le papier, comme au début de sa carrière. Pour avoir commencé dans le métier tout en bas, comme contrôleur du pressage des disques, il sait comment ceux-ci se fabriquent et dans quels studios ils ont été enregistrés…
Sous le pseudonyme de Claude Dejacques, Claude Bergerat traverse les années 60, 70 qu’il va parcourir comme directeur artistique pour Philips, Festival, Pathé-Marconi. Il sera le 1er directeur artistique dont le nom apparait au dos des disques. La liste des artistes qu’il a accompagnés ou découverts est éloquente : Barbara, Maxime le Forestier, Yves Simon, Nougaro, Higelin. Dans Piégée la chanson, un ouvrage malheureusement épuisé, il raconte avec truculence et une sincérité émouvante l’arrière-boutique, les joies et les déceptions de son métier et l’évolution de la chanson et de la musique enregistrée en industrie. Les studios qu’il visite sont fameux ou n’existent parfois que sur le papier, comme au début de sa carrière. Pour avoir commencé dans le métier tout en bas, comme contrôleur du pressage des disques, il sait comment ceux-ci se fabriquent et dans quels studios ils ont été enregistrés…
Fin des années 50, le disque est un espace vierge
Et parfois, les enregistrements sont réalisés dans des studios qui n’existent pas. Comme chez Concerteum. « Les patrons de Concerteum où se situait cette scène n’avaient pas eu besoin d’inscrire de folklore à leur catalogue. Issus d’Europe centrale, juifs rescapés des camps nazis, ils étaient, dix ans après la fin de la guerre, le témoignage vivant de ce qui s’était passé. L’un des associés s’était planqué en Bretagne pendant l’Occupation, l’autre, le grand maigre, astreint à la chaise longue, n’était toujours pas guéri de la déportation. Le directeur artistique était passé par le camp de Shirmeck tandis que le directeur administratif et du personnel avait pris la bure trappiste. Enfin, le chef des services techniques, un Bulgare, avait échappé à l’étoile de la honte en ne quittant jamais les Halles où il bourrait de bottes de cresson de grands paniers d’osier dont l’un lui servait de dortoir. Deux d’entre eux avaient été dénoncés aux nazis par des voisins. Les deux autres avaient flairé le piège à temps. Trois avaient perdu toute leur famille. Ce préambule expliquera, faute de pouvoir les excuser, les curieuses manières professionnelles de mes nouveaux employeurs.
Dans les années 50, le « domaine » du disque demeurait un espace quasiment vierge. Tout pouvait s’inventer. Le microsillon 33 tours venait d’apparaître. Eddy Barclay et quelques autres se risquaient dans le 45 tours. Bien sûr, les bardes d’avant-guerre et de l’Occupation tenaient encore le haut de la rampe sous la quasi-domination du groupe Pathé-Marconi, maître ès qualité du marché. Polydor, allemand, blanchi par Philips, hollandais, commençait à mordre. Decca suivait, la tête haute, en duo avec RCA. Chant du Monde, vivifié par les productions d’URSS, installation son réseau tandis que s’implantaient, dynamiques, les Français nouveaux : Barclay, Vogue et Pacific, BAM et Le Petit Ménestrel. Américains, CBS et WEA n’étaient que distribués. Soumis à la pression de cet environnement, mes patrons ne donnaient pas dans la dentelle. Il fallait vendre très vite, n’importe quoi, n’importe comment, afin de se constituer une trésorerie dont n’avait pas le premier centime. Alléchés par la magie du produit, les banques avançaient certes, mais se réduisaient facilement dès la première alerte. Seule solution : des banques « récupérées ». Dieu ne sait toujours pas de quelle façon, un petit atelier de pressage avec des employés misérables, un circuit de magasins sous gérance et, bientôt, une chaîne de vente par correspondance qui se voulait à l’image de la très active Guilde internationale du disque (…)
11 et 12 décembre 1967, avenue Hoche (Barclay) l’enregistrement de Bonnie and Clyde
« Aussitôt le premier disque achevé, je m’ingéniai à présenter Brigitte Bardot à d’autres auteurs-compositeurs, en particulier ceux dont je m’occupais, ainsi que la crème des chansons que les éditeurs commençaient à me déverser à flot. Après une visite au « Moulin » chez Brassens à la campagne, je lui proposai non sans mal Serge Gainsbourg auquel elle préférait alors Ricet Barrier et « Stanislas » qu’elle interpréta d’ailleurs à l’occasion de son deuxième show de fin d’année. Enfin la rencontre eut lieu, chez Claude Bolling. Comme il le faisait la plupart du temps, Serge arriva avec cinq lignes de texte griffonnées sur une grande page blanche. C’est, ébauché, l’essentiel, à la fois titre et refrain principal de ce qui sera la chanson qu’il dessine au piano, balancé ad hoc sur le bon tempo : « Je me donne à ce qui me plaît. »
 On ne dit pas non à une esquisse, on accorde un peut-être. On demande à voir, comme au poker, et ça marche le plus souvent, en l’occurrence pour le meilleur, puisque cela découchera sur les titres télévisés de la série Bonnie and Clyde-Harley Davidson et sur la passion, enregistrée sur le vif de Je t’aime moi non plus. C’est au studio Hoche que je les attends vers 10 heures du soir pour la séance d’enregistrement des voix, sans journaliste ni photographe. Ils déboulent d’un taxi noir et dérivent, amoureux fous comme dans la chanson, jusque dans le long couloir qui mène au studio. C’est déjà beau et sitôt lancée la bande du play-back-orchestre sur laquelle ils vont inscrire leur voix, voilà qu’ils rejoignent l’essentiel du mirage où ils basculent, habillés seulement de musique et de mots, ivres d’eux-mêmes, tellement vrais, que la prise effectuée devient plus qu’un simple duo de chanteurs à la mode devant un micro : la trace d’un moment d’éternité.
On ne dit pas non à une esquisse, on accorde un peut-être. On demande à voir, comme au poker, et ça marche le plus souvent, en l’occurrence pour le meilleur, puisque cela découchera sur les titres télévisés de la série Bonnie and Clyde-Harley Davidson et sur la passion, enregistrée sur le vif de Je t’aime moi non plus. C’est au studio Hoche que je les attends vers 10 heures du soir pour la séance d’enregistrement des voix, sans journaliste ni photographe. Ils déboulent d’un taxi noir et dérivent, amoureux fous comme dans la chanson, jusque dans le long couloir qui mène au studio. C’est déjà beau et sitôt lancée la bande du play-back-orchestre sur laquelle ils vont inscrire leur voix, voilà qu’ils rejoignent l’essentiel du mirage où ils basculent, habillés seulement de musique et de mots, ivres d’eux-mêmes, tellement vrais, que la prise effectuée devient plus qu’un simple duo de chanteurs à la mode devant un micro : la trace d’un moment d’éternité.
À la première heure le lendemain, je suis à la cabine de gravure. Cette fois, je sais que Brigitte tient son titre et que ça va aller loin. On fait des copies pour la promotion (celles qui seront sauvées) mais, vers 10 heures déboule un ordre de tout suspendre : l’avocat de Brigitte interdit la publication. L’horreur. Je me barre toute la journée. Impossible de joindre ni Brigitte ni Serge que j’attends en vain assis sur le parapet d’un pont, en face de la cité des Arts où il habite depuis près d’un an. Je ne le retrouverai que le lendemain et pendant une dizaine de jours on se verra beaucoup. Et puis il y aura de nouveau Londres en avril : Initials BB, somptueux, qui remplacera, un temps, le grand titre, inédit jusqu’à ce que Jane Birkin arrive. À peine publié Initials BB, Brigitte Bardot m’appelle. Je vais chez elle. On écoute. Elle est secouée comme je la connais quand elle ne triche pas ; « Appelle Serge, tu veux bien ? ». J’appelle. Je lui passe l’appareil et je descends l’escalier de l’avenue Paul-Doumer sans lui dire au revoir. Les circonstances firent qu’on ne se revit jamais. Je quittai Philips ; elle allait signer chez Barclay… Je n’oublie pas les balades dans Paris, quand j’allais la chercher pour la conduire au studio ou la raccompagner ni les petits mots qu’elle m’adressait de temps en temps, pour me remonter le moral quand je craquais à mon tour ou pour relancer un projet. Tout cela a donné une quarantaine de titres variés, inscrits au catalogue Philips et des rééditions en compact où mon nom ne figure qu’en partie.
Août 1975. Irradié au Château d’Hérouville
« Pour réaliser Irradié, l’équipe s’installa à Hérouville dans une dépendance, genre ferme aménagée. À la console, il y avait, déjà, Laurent Thibault. L’accouchement fut plus difficile que BBH avec des titres qui n’avaient pas mûri, quand bien même ils étaient écrits. Jacques souffrira toujours de ces échéances de création discographique avec des horaires, des réservations, des convocations, des délais, des ceci, des cela. Il vit littéralement son devenir d’artiste et ça peut être au moyen de tout ce qui permet de s’exprimer, dès lors qu’il sent quelqu’un en train de pouvoir échanger quelque chose avec lui. Il perdra, non, il prendra toute une nuit à discuter, lire, jouer des airs alors qu’il DOIT écrire un texte pour la séance du lendemain. Il partira voir un ami, pour la chaleur d’un moment passé ensemble, pour une idée, pour un spectacle (…)
 Studios de Légende, secrets et histoires de nos Abbey Road français
Studios de Légende, secrets et histoires de nos Abbey Road français
Edité par Malpaso-Radio Caroline Média.
45 euros.
4 heures du matin, Hérouville. Séance d’enregistrement. Travail sur Irradié. Il pleut tout droit dehors. Aucune des branches d’arbre que saisit la lumière à travers la fenêtre ne bouge. Elles brillent toutes, parcourues d’ondulations liquides sous leur feuillage fatigué. Jacques est sorti depuis deux heures, parti dormir un peu à la ferme d’à côté où il s’est installé, avec toute sa tribu, depuis le début de l’été exactement. Il n’y a plus personne dans le studio et, sous le grand lustre de fer forgé que Michel Magne avait fait mettre en place sous la charpente à nu du toit, les instruments de musique gisent comme autant d’armes délaissées, de boucliers épars : une guitare électrique, un piano ventre ouvert, une batterie déployée, une basse, des partitions, encore une guitare, une caisse derrière une section de pupitres à musique. Dans la cabine, on n’est plus que trois : le batteur, Laurent Thibault et moi. On écoute les prises, pour analyser les variantes d’un tempo qui ne convient pas à Jacques, pas seulement dans la découpe mais dans la qualité du son qu’il ne retrouve pas enregistré tel qu’il l’imagine (…) L’odeur du tabac froid, répandue partout, mélangée à celle de la cigarette constamment embrasée de Laurent, l’écoute de la même structure rythmique depuis bientôt deux heures créent une sorte de distanciation où je circule sans m’endormir, allant de Mozart au piano, à l’incantation du prince balinais assailli par la sorcière Rangda, sans quitter pour autant le contrôle de l’écoute du titre d’Higelin. Ainsi ma caméra cérébrale explore l’espace que me restitue, sans doute déformée mais sensible, ma mémoire : Michèle (Scharapan) droite sur son tabouret, le cou légèrement incliné, articulant de la main maîtresse et des doigts asservis les passages de l’œuvre qu’elle travaille pour en restituer l’essence, la touche qui seule sera perçue, à la cadence indiquée, comme elle le veut, comme elle le sent. Je tremble. Je ne peux m’empêcher d’infléchir la tête, de bouger l’épaule comme si j’entamais les passes d’une danse le long, comme si je suivais la levée du bras de la pianiste à la fin de l’allegro. Curieusement le tempo d’ici se décompose exactement comme il faut pour guider mon errance. Il est 5h30. Jacques ne devrait pas tarder. Il entre, tout excité, joyeux. On dirait qu’il a dormi dix heures. Il n’a pas dormi. « Venez ! Venez dans le studio. J’ai un truc. J’ai trouvé. Prends, Laurent. Tout de suite ! »
La suite est à lire et découvrir dans Studios de légende, histoires et secrets de nos Abbey Road français
Les extraits précédents sont issus d’un livre épuisé et passionnant :
Claude Dejacques, Piégée, la chanson… ?, Éditions Entente, 1994. Reproduits avec l’autorisation de l’ayant droit, son fils.