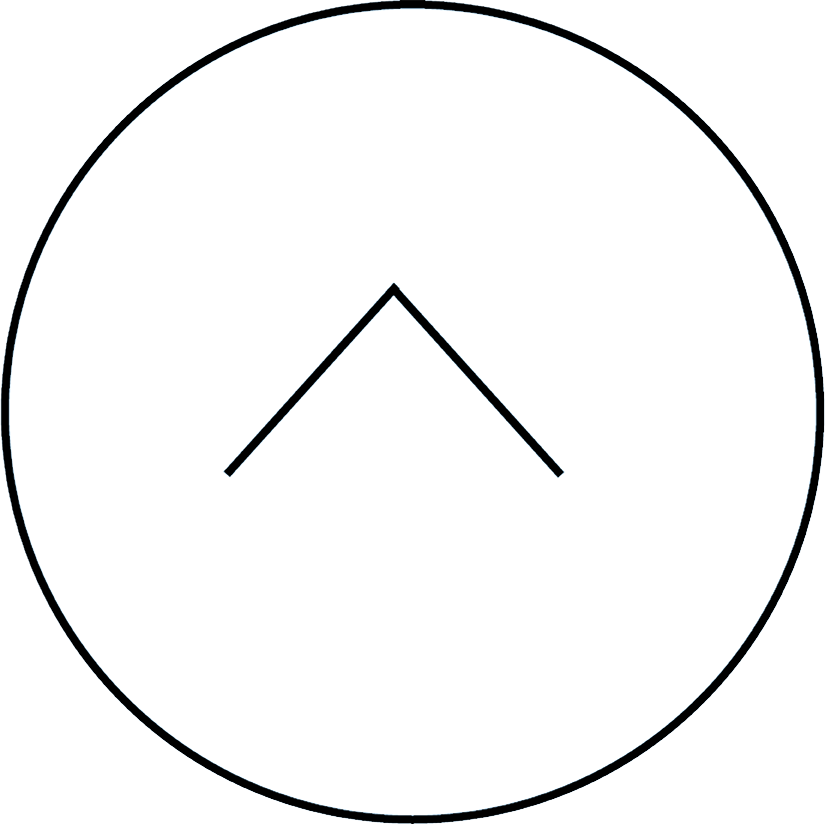Elodie Aubert, ses abricots Polonais et ce qu’en fait le Champion du Monde de Confitures, Stéphan Perrotte
Quel est votre parcours ?
J’ai fait une école d’ingénieur en viticulture et œnologie en Suisse après un BTS en France. Je voulais revenir m’installer sur le domaine familial, y apporter quelques modifications et perpétrer ce que les générations précédentes avaient fait de bien : encourager la diversité des cultures et la biodiversité notamment. En 2007, à la fin de mes études, je suis revenue à Mérindol.
Qu’est-ce qui vous déplaisait à ce moment-là dans votre manière de travailler ?
Mes grands-parents étaient partisans d’une agriculture vivrière : ils produisaient de quoi se nourrir et revendaient le surplus. En 1956, du jour au lendemain, ils perdent l’intégralité de leur production. Tout ce qu’ils avaient alors cultivé, et qui avait mis si longtemps à pousser, meurt après une période de gel. Pour retomber sur leurs pieds, ils privilégient des cultures qu’ils pourront récolter d’ici quatre à cinq ans : l’abricot, la cerise et le raisin de cuve. Nos abricotiers les plus vieux datent donc de cette époque. A cela, j’ai décidé d’ajouter une cave en 2007.
A l’époque, nous vendions nos abricots à un grossiste, sans connaître le prix final. C’est une particularité assez courante du métier d’agriculteur : on envoie les fruits à notre revendeur, et à la fin de la saison, on découvre si on a gagné ou perdu de l’argent. Cette pratique a beau être très répandue, je n’ai pu l’accepter qu’une seule saison. C’est en opposition totale à tout ce que je fais, à tout ce que j’ai commencé à créer. Cette année-là on a gagné un peu, c’était une belle récolte et on fait tout en famille, mais mon père a vendu de nombreuses fois à perte.
C’était assez paradoxal. L’expéditeur trouvait toujours que nous avions les plus beaux abricots, et c’est vrai qu’on a une excellente qualité, en revanche il ne nous payait que très peu. On touchait 20 centimes par kilo, pour un produit qui ne se vend pas à moins de cinq euros le kilo en supermarché, voire plus selon le distributeur.
C’est là que vous décidez de changer de modèle ?
L’année suivante j’avais l’ambition de faire différemment, mais je ne savais pas comment…. Les abricots sont des produits qui périment très vite, alors quitter son revendeur, c’est un saut dans l’inconnu. Presque par chance, il a grêlé, et le grossiste a refusé la totalité de mes fruits, mais je ne me suis pas laissé aller ! Il me fallait trouver une solution, j’ai alors eu l’idée de faire du nectar d’abricot. En me rapprochant d’autres agriculteurs, j’ai appris à confectionner un produit de qualité. Je ne voulais pas faire du bas de gamme, avec des fruits bons pour les poules.
Je les ai donc laissés murir et j’ai sorti un super nectar que j’ai fait goûter un peu partout : à mes clients, sur les salons… j’ai eu des super retours et décidé de travailler autrement l’année prochaine.
Le comité d’entreprise de PSA (Peugeot-Citroën) m’a contacté la première année, pour me demander deux palettes et demie d’abricots, soit environ trois tonnes. On a été tous les deux gagnants. Eux revendaient des abricots de bien meilleure qualité que ce qu’ils avaient auparavant, tout en s’assurant une belle marge, et moi, je touchais deux euros le kilo, soit dix fois plus qu’avec mon grossiste. Vous imaginez le changement que ça a pu être. Ce que je ne vendais pas, je le transformais en nectar.
Vous avez ensuite décidé de développer un circuit court…
J’ai gelé sur certaines années, et les abricots étant un produit à quantité variable, je ne parvenais pas toujours à produire les trois tonnes demandées. Une année je peux ne récolter qu’une tonne et demie de fruits et atteindre les six celle d’après. Au fur et à mesure, je me suis donc éloignée de PSA pour développer mon propre circuit : les particuliers, souvent des amis vignerons, s’inscrivent et demandent les quantités qu’ils veulent, je leur envoie alors une palette qu’ils se répartissent.
Vous produisez des abricots un peu particuliers ?
J’ai deux variétés phares. La première est le Bergeron, je n’en ai pas beaucoup car c’est une espèce commune. La seconde, que mes grands-parents cultivaient déjà il y a soixante ans, est l’Oranger de Provence, qu’on appelait avant le Polonais. Dans le coin, ma famille a été des premières à cultiver l’abricot. L’Oranger de Provence est un fruit oublié, assez rare sur le marché. Il est assez pâle et malheureusement, les gens achètent avec les yeux donc l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) a mis au point d’autres variétés, qui gagnent en couleur ce qu’elles perdent en parfum, en finesse.
Comparé à un industriel vous produisez peu, c’est essentiel pour faire de la qualité ?
C’est incontestable ! Je produis dix à cinquante fois moins qu’un industriel, je peux donc tout ramasser moi-même. Chaque abricot me passe entre les mains et je sais exactement lequel est mûr, ou lequel devra attendre encore une semaine. Des grosses quantités signifient un personnel plus important, rarement assez expérimenté pour déterminer la maturité optimale du fruit. En fonctionnant ainsi, je décide lorsque mes fruits sont prêts, je ne les vends pas au moment où le marché les demande. C’est essentiel pour faire de la qualité.
Quelles autres différences y a-t-il entre votre production et celle d’un industriel ?
Chez moi tout est naturel : je respecte la nature et lui rend ce que je lui emprunte. Je me suis ainsi procuré des brebis pour désherber le domaine. Elles dorment en étable et le fumier qu’elles produisent est le meilleur moyen d’avoir un terrain en bonne santé. En mangeant l’herbe entre les arbres et en y laissant des crottes pleines de graines, elles favorisent énormément la biodiversité. Sur un mètre carré, au lieu d’avoir trois ou quatre espèces d’herbes différentes,je vais en avoir cinquante et c’est ça, la base d’une bonne agriculture. Les plantes attirent ensuite des insectes qui sont essentiels au bon développement des plantes et des fruits. Je n’ai donc plus besoin de traiter, aucun engrais chimique ou pesticide ne rentre sur mes terres.
Vous faîtes aussi du « vin vinifié sans intrants », qu’est-ce que ça signifie ?
Il y a plus de 400 produits œnologiques qu’on peut ajouter au vin et je n’en utilise aucun. Concrètement, mon vin n’est rien de plus que du jus de raisins fermenté.
Une fois qu’on y a goûté, c’est difficile de faire demi-tour. Parfois, lors de dégustations, je goûte un vin conventionnel. Systématiquement, je le trouve éteint. Il n’a pas d’émotions, et on ne ressent aucune continuité entre la vigne et le vin, c’est totalement aseptisé. C’est compliqué de le traduire verbalement, mais je pourrais le comparer aux carottes râpées de supermarché, emballées sous vide. Elles sont assez peu transformées et pourtant, ça a le goût de tout excepté d’une carotte. Le vin conventionnel, comparé à un cépage naturel, c’est un peu ce que la salade en sachet est à la salade de jardin : un produit totalement insipide ! C’est un gros problème, on s’éloigne peu à peu du vrai goût des choses.
Ce constat, si l’on pense à une tomate ou pomme de supermarché par exemple, on peut le généraliser à toute l’industrie ?
Oui et c’est dramatique. Cela s’explique beaucoup par les variétés sélectionnées, créées, faites pour résister trois semaines au frigidaire, mais de la façon de les cultiver également. Cela paraît surprenant, mais l’irrigation fait énormément de tort à l’agriculture, en diluant les saveurs. Vers chez nous, de nombreux vergers poussent le long du Rhône, c’est une hérésie ! Un abricot qui pousse les pieds dans l’eau ne peut avoir le même sucre, le même parfum que celui dont l’arbre se nourrit directement de ce qu’il y a dans le sol. Je n’arrose pas mes abricotiers et l’arbre se nourrit très bien tout seul. Le problème c’est que l’industrie ne tolère pas qu’en cas d’absence de pluie, les fruits sont plus petits. J’estime qu’il faut faire preuve de résilience et accepter quelque chose que l’industrie peine à comprendre : on ne peut, ni ne doit, tout contrôler.
Vous consommez encore des produits de grande surface ?
A titre personnel, je suis totalement sortie des circuits de consommation traditionnels et mon quotidien n’est quasiment fait que de producteurs qui partagent ma vision des choses. Cependant, il m’arrive de faire des exceptions. Hier justement j’ai cédé à la tentation, en achetant une pêche à Biocoop avec mon fils. Je savais que c’était une mauvaise idée : on s’est sincèrement regardé en se demandant ce qu’on mangeait. Les yeux fermés, je n’aurais su dire ce quel fruit j’avais en bouche, et je suis allée à Biocoop, pas à Lidl ou Monoprix.
Ce n’est pas la saison des pêches, il faut l’accepter. A manger local, on évite de transporter, frigorifier et conditionner les fruits ce qui permet d’économiser la saveur des aliments, et de réduire l’empreinte carbone. Mais les modes de consommations actuels sont profondément acceptés et installés, heureusement il existe encore des gens qui veulent quelque chose de différent.
Qui sont ces gens justement, où les trouvez-vous ?
Le bouche à oreille joue beaucoup. Monsieur Perrotte, le confiturier a par exemple goûté mon nectar d’abricots sur un salon, au stand d’un ami vigneron. Il a été surpris par le parfum et disait sentir quelque chose « qu’il ne retrouvait pas d’habitude ». Il a remonté la chaîne pour venir à moi et ça se passe ainsi dans la majorité des cas. Je n’ai jamais eu besoin de me mettre en avant mais je sais que ma production sera écoulée sans souci.
Vous avez des labels, médailles ou autres récompenses ? Est-ce qu’elles ont une valeur réelle ?
Je ne cours pas du tout après et je ne voudrai pas blâmer ceux qui en ont besoin mais je n’en vois tout simplement pas l’intérêt. C’est très répandu dans le monde du vin. De ce que je connais, le jury est composé d’un professionnel et de consommateurs et c’est souvent une personne qui impose son choix. C’est rarement pertinent et encore, c’est sans parler de toutes les médailles qu’il suffit de payer pour obtenir.
Est-ce compliqué de s’émanciper de ce système ?
Oui ça demande énormément de travail et rien n’est jamais acquis. Sans contrats, tout le monde peut me lâcher du jour au lendemain. On choisit de vivre dans une incertitude constante mais je ne pourrai jamais faire marche arrière. C’est difficile parfois et je me fais sans doute plus de soucis que les autres, mais je crois en ce que je fais de tout mon cœur… c’est une conviction politique personnelle et viscérale.